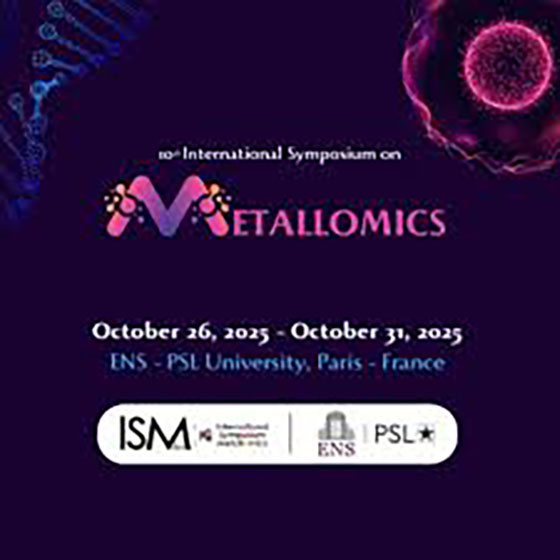
« C’est à l’ENS, en 1869, que la métallomique trouve ses racines, grâce à une découverte de Jules Raulin un collaborateur de Louis Pasteur »
Entretien avec Clotilde Policar, spécialiste en chimie bio-inorganique et directrice des études sciences à l'ENS-PSL et « past-president » de la SBIC (international Society in Biological Inorganic Chemistry)
Comment définir la métallomique ? Quel est le rôle clé des ions métalliques dans les processus fondamentaux de la vie ? À l’approche du Symposium International de Métallomique qui se déroulera à l'ENS-PSL, du 27 au 31 octobre 2025, Clotilde Policar, spécialiste en chimie bio-inorganique et directrice des études sciences à l'ENS, nous éclaire sur les ions métalliques, et leur diversité chimique, impliqués dans les processus les plus fondamentaux du vivant.
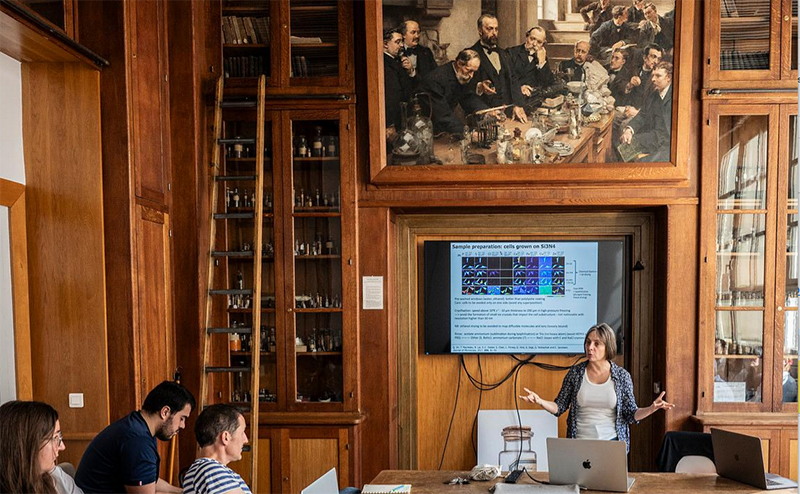
Pouvez-vous nous parler de l’ambition et l’importance du Symposium International en Métallomique (International Symposium in Metallomics, ISM-10) ?
Clotilde Policar : Cet événement sera la 10e édition, et cet anniversaire est une occasion exceptionnelle de mettre en avant les thèmes clés de ce champ, les nombreuses techniques émergentes et les questions contemporaines, et de réunir des chercheurs et chercheuses de différentes disciplines - chimie, biologie, géosciences, sciences du patrimoine et physique - intéressés par les études des systèmes métalliques dans différents contextes.
Si l’essentiel portera sur les études en biologie (cellulaires et in vivo, chez les microorganismes, les plantes et les animaux dont l’homme), l’analyse des systèmes métalliques est aussi pertinente dans les sciences de l'environnement, les géosciences ou les arts car les roches comme les pigments des tableaux peuvent contenir des composés métalliques. Par exemple, la couleur des pierres précieuses ou semi-précieuses est due à des impuretés métalliques ! Et Léonard de Vinci a utilisé de l’oxyde de manganèse pour sa technique très particulière du sfumato (1)
L’ENS est le lieu idéal pour ce congrès anniversaire : c’est en effet ici que la métallomique trouve ses racines, avec la découverte en 1869 de l’essentialité des sels de zinc pour la croissance d’un micro-organisme, par Jules Raulin, un collaborateur de Louis Pasteur (2).
Parce qu’ils sont impliqués dans les processus les plus fondamentaux du vivant, les systèmes biométalliques constituent un réservoir de défis et d’idées pour résoudre des questions aujourd’hui cruciales : utiliser la lumière du soleil, la convertir en énergie chimique ou mécanique, transférer des électrons, utiliser l’hydrogène comme source d’énergie, dégrader des polymères très résistants efficacement et sans polluer, synthétiser des molécules antibactériennes…
Pourriez-vous nous définir la métallomique et ce qu’elle regroupe ?
Clotilde Policar : Les ions métalliques (tels que ceux du fer, du zinc, du cuivre, du manganèse, du molybdène...) sont essentiels en biologie : ils jouent un rôle essentiel dans les processus fondamentaux de la vie tels que la respiration, la photosynthèse, la croissance cellulaire, la régulation ou le maintien du génome, sa lecture, la prolifération cellulaire, la fonction immunitaire, le stress oxydant, les réactions enzymatiques... Les riches propriétés physico-chimiques de ces ions métalliques apportent une diversité chimique en termes de structure ou de réactivité, largement exploitée par les systèmes vivants. On estime que plus de 40 % des protéines contiennent un métal essentiel à leur activité.
En enseignement comme en recherche, les systèmes biologiques sont souvent décrits en omettant ces cations : ils sont pourtant fréquemment liés aux molécules clefs. Par exemple, l’ATP (adénosine triphosphate, une molécule tétra-anionique à pH physiologique) existe dans les systèmes cellulaires à 80 % associée à des cations Mg2+. Ce type d’interactions impacte le comportement en solution, et il n’est pas judicieux d’en faire abstraction (3,4).
En quoi les recherches sur la métallomique sont-elles pluridisciplinaires ?
Clotilde Policar : La métallomique vise à étudier les systèmes métalliques dans différents contextes : il faut sonder le vivant, ce qui implique de la biologie et des études spectroscopiques. Elle s’intéresse aussi à leur répartition dans un échantillon donné : on utilise par exemple des techniques très pointues comme l’imagerie de fluorescence X qui se fait sur des synchrotrons et suppose des développements en physique fondamentale.
Pour comprendre les systèmes bio-métalliques, les chimistes peuvent synthétiser de petites molécules qui reproduisent la fonction des métallobiomolécules. Ces analogues synthétiques biomimétiques peuvent être solubles dans d’autres solvants que l’eau et étudiés à basses températures en solutions fluides (solvants organiques liquides bien en dessous de 0°C) pour caractériser des espèces fugaces : cela implique de la chimie de synthèse. Elle étudie aussi les complexes métalliques qui peuvent être développés par les chimistes comme métallomédicaments : cela implique aussi de la synthèse…
Globalement, l’étude des métallobiomolécules est le lieu d’un partage des compétences entre biochimistes, biophysiciens, chimistes, physico-chimistes, inorganiciens et plus récemment, biologistes cellulaires et chimistes théoriciens. Différentes disciplines ont recours à des techniques d'analyse de la nature ( (ou spéciation) des systèmes métalliques, de leur la structure et de leurs propriétés physico-chimiques : les échanges scientifiques avec la géologie ou les arts ( ainsi certaines techniques pour doser et caractériser les cations métalliques sont développées en géosciences pour étudier les roches ou par les sciences du patrimoine, par exemple pour analyser les pigments métalliques dans les peintures ) peuvent être fructueux et nous profiterons de ce congrès pour ouvrir les frontières de la métallomique à des disciplines variées traitant de la caractérisation des ions métalliques, y compris les géosciences et les arts.
Quels sont les nouveaux champs de recherche de la métallomique et pouvez-vous donner un exemple d’application de ces recherches ?
Clotilde Policar : Des études approfondies appliquant les concepts thermodynamiques et cinétiques, définis par la chimie, dans le contexte de l'intérieur des cellules sont à la pointe de ce domaine. Ces études ont mis en évidence le rôle important des caractéristiques physico-chimiques très spécifiques des milieux biologiques (nature réductrice de l'intérieur des cellules, viscosité élevée, surpopulation moléculaire, environnements compartimentés ou teneur élevée en bases de Lewis et en ions métalliques).
La détermination du comportement des complexes métalliques directement dans l'environnement cellulaire est véritablement une nouvelle frontière : l'imagerie biologique pour accéder à la distribution in vivo ou dans les cellules, y compris la compartimentalisation, la quantification, la spéciation, la réactivité, la dynamique d'échange ou de libération d'un compartiment à l'autre... Il est clair que l'imagerie des ions métalliques a permis de mieux comprendre leur rôle dans les systèmes biologiques, et cette avancée devrait s'accélérer grâce aux capacités de traitement d'images désormais disponibles grâce à l'intelligence artificielle.
Dans les prochaines années, quelles avancées majeures sont attendues concernant l'étude des métaux, et notamment sur l'impact des métaux sur l'environnement ?
Clotilde Policar : Un grand enjeu est une meilleure compréhension de la manière dont les cations métalliques orchestrent les principaux processus fondamentaux du vivant. Étymologiquement, la chimie du vivant est pensée comme relevant exclusivement de la chimie organique, terme forgé au XIXème à partir de la chimie des corps organisés. Sans doute en raison d’un enseignement très cloisonné et du fait de cette étymologie, la communauté travaillant sur les systèmes biologiques oublie souvent ce paramètre métallique dans l’équation. Or l'une des fonctions du vivant est d’accumuler les métaux. Leurs interactions, même fugaces et impliquant des situations d’échange rapide et donc difficile à identifier, avec les molécules présentes dans le vivant (biomolécules naturelles mais aussi médicaments) changent les propriétés de ces dernières : on ne peut donc se passer de la dimension inorganique dans la description des phénomènes biologiques. C’est un enjeu important que de « décarboner » la chimie du vivant et faire sortir de l’ombre ces grands oubliés de la biologie et de la chémobiologie !
Les avancées majeures dans le domaine de la métallomique en général seront sur le terrain de la mise en évidence de la généralité des rôles es cations métalliques : quelques études, alliant analyses biologiques, analyses inorganiques, protéomique ou imagerie, notamment à l’échelle de la cellule unique, sont d’ores et déjà pionnières dans ce domaine. Avec les progrès de l’intelligence artificielle, que ce soit dans le traitement des grands jeux de données ou des images (qui ne sont finalement que des grands jeux de données organisées en 2D), on peut prédire des découvertes importantes dans les prochaines années. Leur caractère essentiel les rend à plusieurs niveaux des cibles intéressantes et encore peu explorées, par exemple pour la lutte contre la multirésistance bactérienne, pour la compréhension de la cancérogénèse, du vieillissement cellulaire… et, partant de là, de leurs contrôles.
Enfin, l’humanité a fondé une société technologique fortement utilisatrice de métaux et aujourd’hui nous sommes face au risque de leur raréfaction. Mais les métaux n’ont pas disparu de la surface de la Terre : ils ont simplement été déplacés des mines à nos appareils électriques qui constituent aujourd’hui de véritables mines urbaines. Il est essentiel de développer le recyclage. Cela peut se faire par des approches chimiques. Et comme le vivant accumule certains métaux, voire est capable de les sélectionner et donc de les purifier, les solutions biologiques de remédiation sont aussi des voies très prometteuses.
Pour finir, i l faut noter par ailleurs que, de manière intéressante, la chimie des systèmes métalliques traverse, comme une ligne de force, l’université PSL, avec un dense réseau sur ces thématiques : on y note la mise au point de catalyseurs ou complexes métalliques (bioinspirés ou non), notamment en lien avec la transition écologique ou la thérapie (ESPCI, ENS, Chimie Paris Tech, Collège de France, Institut Curie), d’approches visant à suivre les cations métalliques dans le vivant et leurs interactions avec les biomolécules (ENS, Institut Curie, Chimie Paris Tech, ESPCI) en lien avec leurs implications dans les processus fondamentaux du vivant ou le développement de pathologies et leur contrôle (Institut Curie, ENS, Collège de France, EPHE), des études sur le recyclage des métaux (Chimie Paris Tech), ou encore des études sur les mécanismes de ces métalloprotéines (Collège de France). Un grand programme de PSL est d’ailleurs en cours pour le développement de ces thématiques et des interactions au sein de ce réseau (Chem Cell State (lien :. https://psl.eu/en/research/universite-psls-major-research-programs).
Références :
|
